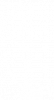Anthropologue, Professeur émérite à la Sorbonne, université Paris Cité, IRD, Ceped, F-75006 Paris, France
Publié en anglais 2021 12, chez Oxford University Press
Scales of Observation, Dominique Desjeux,
https://oxfordre.com/anthropology/view/10.1093/acrefore/9780190854584.001.0001/acrefore-
9780190854584-e-120
Videos on scales of observation:
American video on scales of observation revisited by Dominique
Desjeux: https://vimeo.com/359823108
Chinese scales of observation: https://vimeo.com/359820705
La question des échelles d’observation est née d’un problème pratique auquel je me suis heurté dans les années 1970 en réalisant des enquêtes sous contrat sur des projets de développement rural à Madagascar et au Congo. Elle est devenue ensuite une question théorique qui va permettre de penser autrement non seulement les différences entre les diverses écoles de pensée anthropologiques qui se terminent en « isme », comme évolutionnisme, diffusionnisme, marxisme, fonctionnalisme ou structuralisme, mais aussi les négociations avec les clients publics ou privés pour les amener à financer des enquêtes anthropologiques portant sur des processus d’innovation en entreprise, sur la vie quotidienne des consommateurs, sur des problèmes urbains, sur les pratiques de mobilité, les situations de handicap, des nouvelles technologies de la communication ou les conditions de travail dans les ateliers.
Le relativisme méthodologique des échelles d’observation : comment expliquer que des résultats d’enquête soient contradictoires et vrais en même temps
À Madagascar, entre1971 et 1975, je mène une étude de terrain sur un projet de développement rizicole sur les Hauts Plateaux malgaches. Il cherche à introduire plusieurs innovations agricoles : le repiquage du riz en ligne droite, une nouvelle pratique par rapport aux habitudes traditionnelles, la houe rotative qui permet de désherber plus vite entre les lignes de riz et l’engrais NPK (Azote Phosphate Potasse) qui favorise l’augmentation des rendements en riz. En partant du point de vue de l’organisation chargée de la mise en place de l’innovation et du résultat qui conduit à l’augmentation des usages de l’engrais, je conclus que les paysans sont dominés et qu’ils ne possèdent qu’une très faible marge de manœuvre pour accepter ou refuser ces innovations. Ils sont contraints de sortir de leur économie de subsistance pour entrer dans une économie de marché. Mais cette enquête était peu centrée sur les paysans qui étaient comme une « boite noire » à l’intérieur du processus d’innovation. En se centrant sur la « bureaucratie », la domination devient l’explication principale du changement dans cette société agraire.
Au Congo, entre 1975 et 1979, j’ouvre la « boite noire » des paysans et j’observe à l’inverse qu’ils sont des acteurs stratèges avec des marges de manœuvre qui leur permettent de réinterpréter les objectifs du projet agricole. Celui-ci cherche à développer le maraîchage dans les bas-fonds de la région du Pool. Les paysans développeront la culture du manioc ce qui n’était pas prévu au point de départ du projet. Avec ce nouveau découpage, les marges de manœuvre sont plus explicatives que les effets de domination.
Je découvre donc que suivant le découpage choisi pour faire une enquête le résultat n’est pas le même. Le découpage de la réalité sociale est donc déterminant dans la façon de déchiffrer la réalité observée en termes de domination, de marge de manœuvre ou de liberté. Pour une entreprise qui cherche à comprendre ses consommateurs, un gouvernement qui cherche à mettre en place une politique publique ou une O.N.G. qui veut développer un nouveau service d’aide aux populations, le choix de l’échelle d’observation est donc stratégique.
Plus tard, je découvrirai à travers de très nombreuses enquêtes qualitatives menées en Afrique, en France, aux États-Unis, au Brésil et en Chine pour des entreprises, des administrations ou des O.N.G., que plus je choisis une échelle macrosociale plus j’observe des effets de domination et plus je me centre sur l’individu et plus j’observe de la liberté. Aux échelles d’observation intermédiaires, j’observe des marges de manœuvre c’est-à-dire des situations où les acteurs ne sont ni entièrement libres, ni entièrement dominés, mais qu’ils agissent sous contraintes de situation. Si on continue à descendre vers des échelles de plus en plus micro, on constate que la liberté disparaît au profit des déterminations biologiques ou chromosomiques.
Paradoxalement, toutes ces observations sont vraies : dans la réalité sociale, on peut observer soit de la domination ou des formes de déterminisme, soit des marges de manœuvre, soit de la liberté, mais pas les trois en même temps. De façon métaphorique, on retrouve le principe d’Heisenberg en physique quantique qui déclare qu’on ne peut observer en même temps la position et la vitesse d’une particule, mais que la masse reste constante. Cela veut dire qu’on ne peut observer en même temps tous les éléments de la réalité sociale, mais que la réalité observée reste la même. Les résultats de l’observation et leur interprétation dépendent donc d’abord de l’échelle d’observation qui a été choisie et ensuite, mais ensuite seulement, du choix d’une théorie « déterministe » ou du libre arbitre. Le terme déterministe est utilisé entre guillemets parce que dans les sciences humaines et sociales il n’existe pas vraiment de déterminisme à l’inverse de ce qui existe dans les lois physiques.
Le plus compliqué à comprendre dans l’approche méthodologique en termes d’échelles d’observation, dans les sciences humaines et sociales, est que le modèle théorique est dépendant du découpage qui a été fait par l’anthropologue. La théorie n’est pas absente, mais elle devient une variable dépendante de l’observation, à l’inverse de ce qui est le plus souvent enseigné dans les milieux académiques. Cela ne veut pas dire que les théories sont fausses, mais veut dire que leur portée interprétative est limitée à l’échelle d’observation à partir de laquelle elles ont été construites. En un sens, toutes les théories sont vraies, sous réserve que le recueil des données ait été fait avec rigueur. C’est pourquoi elles sont plus cumulatives qu’antagonistes, si on accepte qu’il ne soit pas possible d’expliquer les réalités sociales de la géopolitique à l’individu d’un seul coup d’œil explicatif et donc qu’aucune théorie n’est généralisable à l’ensemble des comportements humains.
Il n’existe pas d’approche globale. Il n’existe que des généralisations limitées à une échelle d’observation. Cela veut dire que si la réalité forme un tout, l’observation de cette réalité est discontinue. Cela veut dire aussi que l’explication causale change en fonction des échelles. Ces deux conclusions sont souvent très difficiles à admettre parce qu’elles heurtent le besoin de cohérence et de maîtrise de la réalité qui est en chacun de nous. À l’inverse, l’approche par les échelles permet d’accepter que l’on n’ait pas tout vu et que des collègues ou des concurrents aient vu des choses tout aussi intéressantes, mais avec des découpages différents. L’avantage est que cette méthode justifie les approches pluridisciplinaires et permet des négociations pragmatiques pour résoudre les problèmes qui sont posés aux anthropologues. Cela veut dire aussi que la vérité absolue n’existe pas, mais qu’il n’existe que du vrai limité sous contrainte de méthode. Accepter que le vrai est limité, et non pas absolu, tout en restant vérifié et rigoureux, permet de négocier et donc de coopérer et d’agir.
Des niveaux d’observation aux échelles d’observation ou la mise en évidence de la discontinuité de l’observation et de la variabilité des causalités
Il n’est pas trop difficile de comprendre que quand on change de niveau d’observation (level of observation), que l’on passe de l’individu à la famille, de la famille à l’organisation et de l’organisation à la classe sociale le contenu de l’observation change[1]. Ce qu’on observe à un niveau disparaît de l’observation quand on change de niveau[2]. Cependant, une erreur de méthode classique est de penser que si l’on mène des observations au niveau individuel et que l’on n’observe pas de classes sociales, celles-ci n’existent pas. L’approche par les échelles d’observation demande d’être agnostique et d’accepter que si on ne voit pas quelque chose cela ne veuille pas dire qu’elle n’existe pas. En changeant de niveau d’observation ou de découpage à un niveau donné, un phénomène invisible au niveau individuel peut devenir visible au niveau collectif. Le paysan dominé peut devenir un acteur stratège en changeant l’angle d’observation.
Par contre, il est plus difficile d’accepter qu’une variable qui était indépendante à l’échelle macrosociale devienne une variable dépendante de la situation et du jeu des acteurs aux échelles meso et microsociales. La grande différence entre une approche par des niveaux d’observation ou par les paliers[3] et une approche par des échelles d’observation est que l’approche par les niveaux postule qu’il existe une continuité de l’observation du réel et que la causalité ne change pas. L’indicateur de la causalité vient de la mise en évidence des corrélations que l’on peut faire apparaître sur le modèle des enquêtes quantitatives ou des sciences expérimentales. Dans ce cas, les résultats de l’expérimentation sont associés à une formule du genre « toutes choses étant égales par ailleurs », c’est-à-dire au sens strict de « hors situation ».
À l’inverse, l’approche par les échelles montre qu’il n’existe pas de continuité de l’observation du réel depuis l’échelle microindividuelle, celle des personnes, des sujets ou des individus jusqu’à l’échelle macrosociale, celle des appartenances sociales et culturelles, de la macroéconomie ou de la géopolitique. Aux échelles intermédiaires meso et microsociales, l’effet de situation devient la variable indépendante qui explique le jeu des acteurs en situation d’interactions et sous contraintes matérielles, sociales et symboliques, comme on le détaillera ci-dessous. Ce passage d’une causalité tirée d’une corrélation hors situation à une causalité induite d’un effet de situation sous contrainte explique pourquoi il n’est pas possible d’observer la réalité sociale de façon continue. La régularité hors situation et la réalité en situation ne peuvent s’observer en même temps parce que le régime de causalité est discontinu.
De façon conventionnelle, puisque les échelles n’existent pas dans la réalité, il est possible de distinguer quatre grandes sortes d’échelles d’observation dans les sciences humaines et sociales. L’échelle macrosociale est celle de la géopolitique, des grands clivages sociaux, des aires culturelles ou des sondages d’opinion. L’échelle microindividuelle se focalise sur l’individu. Entre les deux se trouvent l’échelle mesosociale qui décrit des grandes organisations et des systèmes d’action collectifs ainsi que l’échelle microsociale qui décrit des acteurs en interaction dans l’espace domestique, du travail, des loisirs et des courses. Autant il est possible de faire des liens entre l’échelle macrosociale et l’échelle microindividuelle, comme le font les économistes quand ils postulent qu’un effet macroéconomique est la résultante de l’agrégation des arbitrages coût/bénéfice faits par les individus à partir du signal prix, autant il est impossible de faire une description continue qui partirait des classes sociales, passerait par les organisations et les systèmes d’action familiaux pour aboutir à l’individu pour montrer toute la chaîne concrète des causalités.
Cette conclusion épistémologique de la discontinuité de l’observation et de la diversité des causalités est induite des contraintes concrètes de l’observation sur le terrain. Si l’observation n’est plus la pratique centrale, la question des échelles disparaît. Le « vrai » risque d’être remplacé par « La vérité ». La causalité unique remplace la multicausalité. La réalité devient univoque ce qui élimine toute dimension ambivalente, c’est-à-dire toutes les tensions et les contradictions de la vie sociale.
L’échelle macrosociale, celle des effets d’appartenance sociale et des corrélations hors situation
À l’échelle macrosociale, les jeux d’acteurs collectifs et les personnes individuelles ne sont pas visibles. C’est l’échelle des enquêtes statistiques qui cherchent des régularités en croisant des variables indépendantes, comme le revenu, le diplôme scolaire, la taille de la ville, l’âge ou le sexe avec des variables indépendantes comme les opinions politiques, les comportements d’achat ou les valeurs.
C’est en utilisant cette échelle d’observation qu’Émile Durkheim (1858-1917), un des principaux fondateurs de la sociologie à la fin du XIXe siècle, a pu montrer qu’il existait une corrélation entre le taux de suicide et l’appartenance à une communauté religieuse catholique, protestante ou juive, plus ou moins cohésive, sans faire appel à l’explication par la souffrance personnelle du sujet. Il montre que plus le groupe est anomique, plus le taux de suicide est élevé, ce qui à l’époque, à la fin du XIXe siècle, était le cas des protestants. Son explication ne tient compte ni de la perte de sens de l’individu ni des interactions sociales qui auraient pu conduire au suicide. Son explication est vraie et pourtant elle ne prend pas en compte toutes les dimensions possibles du suicide auxquelles on pourrait, par exemple, rajouter des effets biologiques très micros associés à des comportements dépressifs et suicidaires.
Dans de nombreux pays, on montre qu’il existe une corrélation entre le fait d’appartenir à une classe moyenne à revenu faible et le fait d’être obèse. Le manque de pouvoir d’achat est la cause qui explique pourquoi les populations défavorisées ne peuvent pas acheter des aliments de bonne qualité diététique. En 2018, en France, les consommateurs de produits alimentaires bios ont un niveau d’éducation et de revenu plus élevés que les non-consommateurs de produits bios.
L’échelle macrosociale permet de saisir les quatre grands clivages qui, d’un point de vue anthropologique, organisent tous les ensembles humains et dont les formes ou les expressions varient en fonction de l’histoire et de la culture de chaque société : les clivages de classes sociales ou de strates sociales, de genres ou de sexes, de générations ou d’âges, et enfin de cultures qu’elles soient politiques, religieuses ou ethniques. Ces clivages peuvent relever d’une simple description des différences qui organisent toute société. Ils peuvent aussi servir à décrire les moments de tensions sociales et politiques.
En fonction des époques et de l’histoire de chaque société, les conflits sociaux s’organisent autour des différences de classes sociales, de genre, avec le féminisme par exemple ou les mouvements anti gays, de génération ou de culture, notamment pendant les périodes de montée du racisme. Ces clivages, quand ils deviennent conflictuels, et rappelons-le, ils ne le sont pas en permanence, peuvent avoir des effets importants sur le développement ou au contraire la décroissance de certains marchés. En France, par exemple, en 2019, la société de produits de sport Décathlon a dû abandonner l’idée de vendre un voile musulman adapté à la course à pied pour les femmes, sous la pression d’une partie de l’opinion publique, et tout particulièrement de femmes françaises opposées au voile, le hijab, qui symbolise, pour elle, la domination masculine. En réalité, si la domination est vraie, elle n’explique pas toutes les pratiques du voile.[4]
À l’échelle d’observation macrosociale on présuppose que les comportements individuels sont organisés par des effets d’appartenance sociale et donc par des effets de société comme la domination ou par des régularités entre une pratique et un de ces quatre effets d’appartenance.
Le point important à comprendre est que chaque échelle permet de produire du vrai et donc que ce n’est pas parce qu’une échelle va vers plus de micro, et donc vers ce que l’on pense être plus de précision, ou vers plus de macro, ce qui paraît réducteur à certains, qu’elle soit plus vraie ou moins vraie. Par contre en fonction du problème que l’on se pose, une échelle peut être plus explicative ou plus pertinente qu’une autre. L’approche par les échelles pose autant la question de l’échelle de production des informations et des connaissances que celle de la position des acteurs au moment de la réception, comme celui de la restitution des résultats qui suit l’enquête anthropologique.
La pertinence d’une information qui est produite à une échelle donnée varie en fonction de la position des acteurs qui auront à l’utiliser. Une direction stratégique dans une entreprise pourra être plus intéressée par des données statistiques pour comprendre l’évolution de son marché que par des données anthropologiques centrées sur l’usage des produits dans la cuisine ou la salle de bain. Ces données sont beaucoup trop « micro » par rapport aux problèmes qu’elle a à résoudre. À l’inverse, un commercial sera probablement moins intéressé par les données statistiques relevant de l’échelle macrosociale que par des données de psychologie microindividuelles qui lui permettent d’acquérir les techniques de persuasion des clients[5], comme par exemple la peur de manquer (annoncer des stocks limités), l’importance du don et du contre don (promettre des frais de port gratuit dans le cas du e-commerce), la légitimité de l’expertise (mettre en scène des personnages en blouse blanche pour signifier la scientificité, dans une publicité).
L’échelle microindividuelle, celle de la personne ou du sujet, de la psychologie cognitive, des motivations, de l’inconscient psychanalytique, de la rationalité ou de l’incohérence en économie
Dans les entreprises, la plupart des clients qui ont à travailler avec des anthropologues ont reçu une formation d’ingénieur, de médecins, d’architectes ou de cadre dans une « école de commerce », comme on dit en français. Ils sont donc habitués aux enquêtes statistiques macrosociales dont l’objectif est de quantifier les phénomènes et de chercher des fréquences. Le vrai est associé aux seuls résultats quantifiés.
Ils sont aussi plus ou moins familiers avec les méthodes des recherches expérimentales dont un des principes est de rechercher une variable explicative de l’occurrence ou de la variation des phénomènes. Pour mesurer l’effet de l’azote sur le rendement des cultures, un ingénieur va faire varier la quantité d’azote mise dans plusieurs bandes de terrains identiques et dans lesquelles la quantité de phosphate et de potasse reste constante. Cela lui permettra de montrer quelle est la quantité d’azote optimale nécessaire pour améliorer les rendements. Ce n’est bien sûr qu’un exemple puisqu’aujourd’hui une grande partie des recherches expérimentales se font à travers des logiciels de simulation probabiliste ou grâce aux « Big Data » et suivant des méthodes beaucoup plus inductives et exploratoires.
Dans ces méthodes, l’effet de situation n’est pas pris en compte et c’est ce qui en fait leur intérêt, mais aussi leurs limites. Il est possible de montrer en laboratoire quelle est la quantité d’azote la plus efficace pour augmenter les rendements, mais si on réalise une enquête dans les champs et non plus en laboratoire comme cela a été réalisé en Thaïlande, il est possible de montrer que la faiblesse des rendements est d’abord due à la présence de prédateurs qui mangent les jeunes pousses de riz.
Surtout, plus dans les pays occidentaux que dans les pays orientaux comme la Chine, de nombreux clients mobilisent implicitement un modèle psychologique et individuel, fondé sur l’explication des comportements humains par les motivations, la rationalité économique, la sensorialité, les émotions, les valeurs ou les biais cognitifs.
La psychologie cognitive, par exemple, a fait ressortir de nombreux biais comme la « loi des séries » à laquelle croient de nombreux joueurs de loto ou de jeux de hasard, comme l’ont montré des enquêtes anthropologiques que nous avons menées pour la Française Des Jeux[6]. Le « biais de confirmation », comme le rappelle Gérald Bronner[7], consiste à voir dans une série un sens, un signe du destin, tout en oubliant qu’il aurait pu exister de très nombreuses autres possibilités, car on oublie la taille de l’échantillon. « L’illusion de contrôle » est un biais important qui a été montré en 1975 par Helen Langer : c’est une tendance à surestimer la maîtrise que l’on a du hasard ou du futur[8]. Tous ces biais jouent un rôle important sur les arbitrages individuels et les prises de décision que ce soit pour acheter, se marier, parier ou faire des dons. Bien évidemment, toutes ces approches sont pertinentes à l’échelle d’observation microindividuelle, que le découpage porte sur la rationalité individuelle, l’inconscient ou les tunnels cognitifs. Cette échelle correspond aussi aux théories de psychologie économiques de George A. Akerlof, prix Nobel d’économie en 2001, et Robert J. Shiller, dans Les esprits animaux (2009).[9] L’individu est l’unité de base des observations.
La causalité qui est prise en compte est celle qui est interne à l’individu à l’inverse des approches macrosociales qui portent plus sur les causalités qui influencent les comportements individuels. L’effet d’agrégation des décisions individuelles est une des méthodes utilisées pour passer de l’échelle microindividuelle à l’échelle macrosociale. Une autre consiste à aller interviewer les individus pour comprendre leur comportement ou leurs valeurs, afin de permettre aux chercheurs, aux consultants ou aux clients d’expliquer les résultats trouvés à l’échelle macrosociale déjà réalisée. La plupart de ces approches s’intéressent plus au sens et aux représentations que les acteurs ont de leur action qu’aux interactions entre acteurs et aux pratiques qu’ils mobilisent dans leur vie quotidienne. Elles se concentrent sur l’image de soi, sur l’identité, sur la confiance, toute dimension importante du point de vue du sujet individuel, puisque la perte de sens peut conduire à la dépression et au suicide, mais dont la dimension explicative devient faible quand on change d’échelle pour observer des actions collectives dans des organisations ou des institutions qui transforment les comportements individuels en jeux d’acteurs collectifs.
Le plus souvent cette dimension collective et interactionniste est absente du mode de raisonnement et d’explication de nombreux clients. Ils sont plus intéressés par les dimensions imaginaires et symboliques qui ont été développées par une partie de l’anthropologie que par les relations de pouvoir entre acteurs ou l’importance des contraintes qui varie en fonction des situations concrètes. L’imaginaire leur permet d’enchanter le monde sur lequel ils doivent agir. Le réalisme anthropologique indique le chemin de l’action, mais sans l’enchanter.
Les échelles mesosociales et microsociales, la focale d’observation anthropologique des jeux d’acteurs sous contrainte de situations[10]
Les échelles macrosociales et microindividuelles sont des approches « fluides » qui postulent soit que les actions collectives dépendent d’abord des individus et que la connaissance des valeurs, des idées, du désir, des bonnes raisons ou de l’émotion d’un acteur expliquent son passage à l’action, soit que les individus sont dominés et donc que leurs comportements sont conditionnés par des effets d’imposition, par des habitus. Ces deux approches sont tout à fait observables dans la réalité sociale, mais il faut juste rappeler que si on accepte l’approche par les échelles d’observation chacune n’est valable qu’à l’échelle d’observation où elle a produit ses connaissances. L’explication des sociétés ne se réduit ni aux effets de domination ni aux effets d’agrégation individuelle elle passe aussi par l’observation du jeu des acteurs comme on peut le faire aux échelles mesosociales et microsociales. Ces deux échelles, qui relèvent du même paradigme interactionniste en situation, montrent qu’il existe un écart important entre ce que pensent les acteurs et ce que font les acteurs et que cet écart s’explique par les contraintes qui s’interposent entre la pensée et l’action et qui varient en fonction des situations.
Les deux échelles mesosociales, celle des organisations, et microsociales, celle des familles et de la parenté, ont été séparées pour des raisons pratiques. À l’origine l’échelle mesosociale ne s’appliquait qu’aux enquêtes sur les grandes organisations et sur les systèmes d’action comprenant par exemple les acteurs politiques et administratifs, les groupes de pression privés ou associatifs, le monde académique, les médias ou les entreprises.
Cette échelle est spécialement utilisée pour analyser le fonctionnement des entreprises, des administrations ou des associations, les modalités de leur changement et les processus d’innovation qui les traversent. L’observation s’appuie sur le modèle de l’acteur stratégique qui trouve son origine chez Alvin W. Gouldner dans Patterns of Industrial Bureaucracy (1955)[11] aux États-Unis, chez Michel Crozier en France dans Le phénomène Bureaucratique (Seuil, 1963)[12] ou encore chez F. G. Bailey dans Strategems and Spoils pour les systèmes politiques[13].
De façon simplifiée, l’enquête consiste à repérer les acteurs sociaux qui sont en interaction les uns avec les autres depuis les départements de recherche et développement ou d’innovation jusqu’à la direction commerciale, en passant par la production et la direction marketing, ou encore depuis la Présidence (CEO) jusqu’au travail à la chaîne dans les usines, le tout sous la contrainte du système de distribution et de consommation du client final. Élisabeth Briody nous donne un bon exemple d’enquête anthropologique sur les ateliers de General Motors où les ouvriers font des surstocks de pièces détachées pour compenser les retards qui viennent des pannes de la chaine de production pour éviter ainsi d’être blâmés (p.57)[14].
Ces acteurs sont organisés en réseaux « prénumériques » et numériques depuis les années 2000. Les réseaux prénumériques sont constitués à partir des liens familiaux, ethniques, scolaires avec les anciens d’une même école ou d’une même université, politiques, professionnels, religieux ou culturels. Dans son enquête sur les équipages de pilote chinois, Allen Batteau montre comment la famille sert de modèle pour gérer la distance et la proximité entre les membres d’équipage chinois et étranger. Pour les Chinois, les membres étrangers seront plus compliqués à gérer, car ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la famille[15].
À l’intérieur de ces réseaux circule de l’information qu’elle soit orale ou digitale. Le contrôle de l’information pertinente reste un des éléments stratégiques du jeu de la coopération ou du conflit entre les acteurs, ainsi que son traitement. Allen W. Batteau dans son enquête ethnographique sur la technologie dans le monde de l’aviation aborde la question de l’information sous l’angle de la capacité qu’ont les pilotes de traiter une quantité limitée d’information pour garantir la sécurité du vol. Il montre que le problème est le même au sein des centrales nucléaires. Trop d’information émousse les capacités de réaction des acteurs[16]. C’est pourquoi une grande part des « erreurs humaines » ne relève pas tant de la responsabilité individuelle que du contexte organisationnel dans lequel ils agissent (p. 75 et sq.).
Pour un acteur-stratège, l’objectif est d’obtenir l’information pertinente pour son action que ce soit pour la développer ou pour la protéger. La multiplication de l’information digitale, accessible à tout le monde, a rendu encore plus stratégique l’accès aux informations pertinentes. Il ne suffit pas pour un acteur d’être un bon programmateur, même si c’est une expertise stratégique aujourd’hui, il faut aussi être un bon agrégateur d’informations, de réseaux sociaux et de financeurs en interne ou en externe de l’entreprise. Un cadre qui veut survivre dans une entreprise doit obtenir un budget auprès de sa direction. Cela n’est pas réservé aux start-up.
Les enquêtes anthropologiques stratégiques cherchent à faire ressortir les zones d’incertitudes autour desquels s’organisent les relations de pouvoir et de coopération entre les acteurs de l’entreprise en interne et en externe. Les enquêtes anthropologiques rappellent l’importance de la conflictualité dans les relations humaines et qu’une partie de cette conflictualité s’organise autour du contrôle de l’information. Une des sources d’incertitudes les plus importantes aujourd’hui est la connaissance du client que ce soit une entreprise, en BtoB, ou un consommateur final, en BtoC, ou entre consommateurs en CtoC. L’acteur qui maîtrise cette zone d’incertitudes possède une forte maîtrise du jeu qui organise l’entreprise. D’autres acteurs peuvent contrôler les règles du jeu financier et budgétaire, comme les contrôleurs de gestion. D’autres encore contrôlent l’accès aux approvisionnements dont le prix d’achat conditionne le prix de revient du produit final. Le point important à retenir est que si la situation change le jeu entre les acteurs change.
Si la zone d’incertitude se déplace parce que, par exemple, le prix de l’énergie baisse, ou parce que les cours des matières premières montent, ou encore parce que les modes de vie changent, toutes les interactions entre les acteurs en interne de l’entreprise et tout au long des filières professionnelles qui partent de la production pour aller jusqu’à la distribution, en sont transformées. Le développement de la classe moyenne supérieure chinoise, par exemple, a entraîné une très forte consommation de la viande de porc qui à son tour a entraîné une augmentation des cours du soja, ce qui a conduit à une augmentation des coûts de production du porc en France qui à leur tour ont pesé sur le pouvoir d’achat de la classe moyenne basse française. Ces changements macrosociaux ont une incidence forte sur le fonctionnement des entreprises et notamment sur la compétition entre les directions de la recherche, de l’innovation et du développement, et les directions marketing[17].
C’est pourquoi, dans cette approche stratégique, les valeurs et le sens existent bien, mais ils sont des variables dépendantes de l’effet de situation et des relations de pouvoir et des différences d’intérêts entre les acteurs. Les valeurs jouent principalement un rôle de justification des stratégies mobilisées par les différents groupes d’acteurs ou un rôle d’enchantement de la réalité managériale qui est souvent dure et stressante du fait de la compétition internationale. L’explication par les valeurs, par les croyances, par la vision ou par l’identité relève d’un mécanisme anthropologique très ancien de libération dans l’imaginaire des contraintes réelle du quotidien. Plus la réalité est difficile plus il est nécessaire de produire du sens pour la rendre acceptable, et ceci grâce à deux imaginaires, l’un qui est messianique et qui annonce un monde futur merveilleux, comme dans la publicité[18] et une partie des approches managériales, l’autre qui est apocalyptique, comme dans certains mouvements militants politiques ou religieux. À ces deux échelles d’observation, des enquêtes anthropologiques doivent sans cesse se déplacer entre un monde réaliste et un monde imaginaire pour expliquer les jeux collectifs.
Au début des années 1990, l’approche stratégique a été appliquée aux systèmes d’action domestiques composés, en fonction des situations, d’un plus petit nombre d’acteurs appartenant à la sphère familiale, quelle que soit la nature juridique de ces liens de parenté, notamment par rapport à l’union libre ou aux familles recomposées. Dans cette approche, les différents acteurs, conjoints, enfants, beaux-parents, grands-parents interagissent les uns avec les autres dans des espaces concrets comme la cuisine, le living, la salle de bain, la chambre à coucher, le bureau, le jardin ou le garage, l’existence de ces lieux variant en fonction des pays et des revenus des ménages. Une division sexuelle des tâches peut se développer autour des activités ménagères, du suivi des enfants, du bricolage ou du jardinage. Ces activités sont rendues possible grâce à l’acquisition de nombreux objets domestiques avec l’électroménager, et particulièrement la machine à laver le linge qui conditionne toute l’organisation de la vie familiale et le réfrigérateur qui transforme le système de course, comme cela a émergé dans les années 1920 aux États-Unis, 1950 en Europe de l’Ouest et 1990 dans les BRICs (Brésil, Russie, Inde et Chine), la ou les voitures pour la mobilité, la chaudière pour le chauffage de la maison et l’eau chaude, et tous les objets de la communication depuis la télévision jusqu’au téléphone mobile en passant par la tablette et les consoles de jeux vidéo, dont l’usage est rendu possible par la diffusion de plus en plus importante de l’énergie électrique à travers le monde.
L’anthropologie introduit la culture matérielle, la logistique et la composante énergétique comme analyseurs de la consommation[19]. Elle constitue la base de la plupart des enquêtes anthropologiques depuis Malinowski et les Argonautes du Pacifique[20] ou Marcel Mauss sur les Inuits[21]. Ici, le terme de symbolique renvoie au monde des représentations, de l’imaginaire et des valeurs ou de l’identité.
À l’échelle microsociale, à ne pas confondre avec l’échelle microindividuelle qui porte sur les individus même s’il est possible de faire des rapprochements entre ces deux échelles, la consommation change de sens. Elle devient une activité collective. Les décisions ne se limitent plus à des arbitrages individuels à un moment donné. Elles deviennent des processus dans le temps qui s’organisent autour d’un itinéraire aux embranchements alternatifs, entre le « click » et le « mortar » et où se négocie en permanence, de façon pacifiée ou conflictuelle, des intérêts et du sens entre les acteurs du système familial.
La dimension symbolique de l’anthropologie est facilement utilisée par les entreprises. À l’inverse, la dimension conflictuelle évoquée ci-dessus et qui pourtant influence le comportement des consommateurs est très difficilement réappropriable par les directions marketing et de la communication.
La méthode des itinéraires : une méthode pour comprendre les jeux d’acteurs sous contrainte de situations aux échelles mesosociales et microsociales.
La méthode des itinéraires relève d’une double transposition. À l’origine elle a été construite sur le modèle des itinéraires techniques agricoles depuis le labourage jusqu’à la moisson, en passant par le semis et le traitement des cultures. L’objectif était de montrer que la consommation ne se limitait pas au moment de l’achat, mais qu’elle était la résultante d’une construction sociale comprenant plusieurs étapes. La deuxième transposition vient de l’analyse des organisations qui montrent que la décision ne se réduit pas à un moment et à un seul décideur, mais qu’elle est un processus dans le temps, collectives et itératives. La décision n’est pas linéaire. Sa rationalité ne relève pas de la seule rationalité technique, médicale ou économique. Elle relève des interactions entre les acteurs de l’univers domestique, en interne et en externe de la famille. La rationalité d’une décision relève d’une logique souterraine, celle du jeu des acteurs aux échelles mesosociales et microsociales, celle de l’évolution des modes de vie et de la géopolitique à l’échelle macrosociale.
La méthode consiste à rechercher l’événement déclencheur du processus de décision d’acquérir un bien ou un service ou de toute autre action relevant de la même échelle. Cet événement peut-être un anniversaire, un deuil, un départ à la retraite, l’arrivée du week-end, la panne d’un appareil domestique. L’événement déclencheur explique pour une part ce que le marketing appelle la motivation. Cet événement déclenche la mise en route d’un jeu d’acteur familial plus ou moins important. Quand les tâches sont routinières, comme les courses du week-end au supermarché, cette mobilisation peut-être faible. Elle peut au contraire produire des moments très émotionnels, si l’un des membres de la famille est plus directement concerné, et notamment les enfants au moment de la rentrée scolaire quand il faut acheter un nouveau cartable avec une marque spécifique, des nouvelles baskets, un nouveau jean ou des nouveaux T-shirts[22]. L’étape de l’événement déclencheur est une étape de négociation entre les membres de la famille. Elle est suivie soit d’une étape de recherche sur Internet, voire d’un achat sur Internet, cette étape pouvant aussi précéder l’étape de l’événement déclencheur.
Les acteurs vont aller faire leurs courses en voiture, à pied, en transport en commun, en vélo ou en trottinette ou se faire livrer. Le moyen de transport logistique détermine pour une part la quantité de biens et de produits qui seront achetés. Dans le lieu d’achat, d’autres négociations pourront avoir lieu entre les membres de la famille.
Une fois retournés dans le logement, les objets vont être rangés dans le réfrigérateur et les placards. Le contenu du réfrigérateur est un analyseur des pratiques du consommateur. Aux États-Unis on peut trouver beaucoup de sauces en bouteille dans la porte du réfrigérateur, alors qu’on France trouvera plus de bouteilles de vin, pour prendre un exemple un peu caricatural. Si la consommation concerne l’alimentation, la cuisine va jouer un rôle plus ou moins important en fonction des cultures et des traditions historiques de chaque pays. En France et en Chine, les pratiques culinaires domestiques sont encore très importantes. L’étape qui suit est celle de l’usage ou de la consommation puis celle des déchets ou du recyclage des produits non utilisés. Toutes ces étapes qui se déroulent depuis l’événement déclencheur, jusqu’à la mobilité, l’achat, le rangement, l’usage, les déchets et le recyclage, peuvent varier en fonction des produits ou des services, en fonction de l’état d’avancement du système de digitalisation par Internet, sur téléphone mobile, que ce soit pour acheter ou pour payer.
À chaque étape l’anthropologue va montrer que les jeux d’acteurs se déroulent dans des lieux spécifiques. Dès les années 2000, il a été possible de montrer que le living était une pièce stratégique pour les entreprises qui vendaient des technologies de la communication, car une grande partie des pratiques se déroulait dans cette pièce. Certaines de ces pratiques étaient conflictuelles comme l’accès à la télévision ou au téléphone. Le développement des écrans sur ordinateur et du téléphone mobile a fait baisser une partie de la conflictualité dans les familles autour de ces objets, tout en augmentant l’anxiété d’une partie des parents qui cherchaient à mieux contrôler les usages des écrans par leurs enfants. La salle de bain peut-être un haut lieu de conflictualité le matin si l’un des membres de la famille passe trop de temps alors qu’il faut se dépêcher pour partir à l’école ou aller au travail. Tout ceci montre que la consommation ne se réduit pas au moment de l’achat, que le moment de l’usage fait partie intégrante du processus social, mais surtout qu’à toutes les étapes du processus les interactions sociales peuvent transformer les décisions d’acheter ou de ne pas acheter. Ces décisions sont sous contrainte matérielles, sociales et symboliques.
Ces contraintes apparaissent grâce à une observation des pratiques sur les lieux de leur mise en action. Observer et décrire permet de faire apparaitre la consommation comme un système d’action qui intègre l’espace domestique, la mobilité, les pratiques digitales et le lieu d’achat.[23]
Les 10 grandes contraintes anthropologiques qui organisent les comportements d’achat et la diffusion des innovations à l’échelle microsociale
Avant de décrire les principales contraintes qui organisent le comportement des consommateurs et au-delà de la consommation, de tous les comportements qui concernent la vie quotidienne, il faut rappeler qu’une contrainte est autant un frein à l’action ou à l’achat qu’une potentialité. Si la situation change, la contrainte peut devenir une potentialité. Un exemple classique le rappelle : le vent peut-être une contrainte pour une voiture ou un avion en mobilité et en même temps une potentialité pour un bateau à voile. Une contrainte ou une potentialité n’existent pas en soi. Elles dépendent de la situation. Elle est au cœur du handicap humain. En français on parle de moins en moins aujourd’hui d’une personne handicapée, mais on dit une personne en situation de handicap. Le terme de situation n’enlève pas le handicap physique ou mental, mais il montre que les contraintes liées au handicap varient suivant que la société prend ou non en compte la situation de handicap.[24]
Les quatre premières contraintes sont matérielles. Chaque acteur individuel peut gagner ou perdre au changement. Cet enjeu explique la dimension conflictuelle de la consommation. Chaque contrainte renvoie à une série de questions qui portent sur le système de décision des acteurs.
Le temps est la première contrainte : est-ce que le changement proposé fait gagner ou perdre du temps à tel ou tel acteur. La deuxième contrainte porte sur l’espace : est-ce que l’espace physique est suffisant ou adapté à la pratique du bien ou service proposé. Une cuisine trop petite peut limiter certaines pratiques culinaires. Le manque de garage ou d’un grenier peut empêcher le développement du bricolage. Le budget est la troisième contrainte : est-ce que l’achat ou le changement sont supportables financièrement. La contrainte de prix est la plus forte du point de vue des classes moyennes les plus démunies. L’enchantement publicitaire a peu d’effet face à cette contrainte. Le système d’objets concrets représente la contrainte la plus anthropologique. Dans les observations de terrain, on regarde si l’acquisition d’un nouvel objet ou d’un service pourra fonctionner dans l’espace domestique, et donc on se demande si tous les objets nécessaires à l’usage d’un objet particulier sont bien en place dans le logement.
Par exemple si quelqu’un veut acheter un produit surgelé, il faut se demander s’il possède bien un réfrigérateur et un département congélation, plus un sac spécialisé pour garantir la chaîne du froid entre le magasin et chez lui. Cela peut sembler évident dans les pays développés, cela l’est beaucoup moins dans les pays du Sud. De même, il faut se demander si le logement a un accès à l’énergie électrique ou à l’eau courante. En Chine où l’eau n’est pas potable, le système d’objets de production de l’eau potable comprend le robinet d’eau courante, la bouilloire électrique, le filtre à calcaire, le thermos pour conserver l’eau chaude, et la théière pour faire le thé. La relative complexité du système d’objets qui demande un certain temps pour produire de l’eau potable explique pour une part le succès de l’eau en bouteille dans les supermarchés[25]. Une des conclusions des enquêtes anthropologiques est de montrer que les chances de réussite d’un nouveau produit sont d’autant plus fortes que celui-ci résout un problème de la vie quotidienne.
Les quatre autres contraintes sont sociales et psychosociales. La charge mentale est la cinquième contrainte : est-ce que le changement ou le nouveau produit fait baisser ou augmenter les préoccupations ou le stress des acteurs. Si la charge mentale augmente, les chances d’adoption du changement sont plus faibles. Cette contrainte explique l’une des difficultés du passage de la croissance économique et de l’adoption des nouvelles technologies du quotidien tel que l’Occident le pratique depuis deux siècles, vers une forme de décroissance ou de déconsommation qui permettrait de limiter les usages des énergies fossiles, des matières premières et de certains produits alimentaires comme la viande en vue de limiter le réchauffement climatique. Cependant, contrairement à l’adoption de la machine à laver qui simplifie la tâche des ménagères, manger plus de légumes et faire la cuisine soi-même augmente la charge mentale d’une partie des femmes qui travaillent, qui ont des enfants et qui gèrent déjà leur journée avec une forte contrainte de temps. Tout cela n’est pas insoluble à terme, mais explique les difficultés concrètes de la transition énergétique. Ce genre de contrainte explique l’écart entre des opinions favorables en faveur de la déconsommation dans une grande partie des pays occidentaux, mais qui sont associées à des pratiques qui sont de fait limitées.
La sixième, la contrainte d’apprentissage, est proche de celle de charge mentale. Si une nouvelle technologie est compliquée à apprendre, il est possible qu’elle ne soit jamais adoptée. La question de l’apprentissage a pris une dimension importante aujourd’hui avec la multiplication des applications digitales, des plates-formes digitales et des codes de sécurité. Une partie des populations vieillissantes ont du mal à rentrer dans l’apprentissage accéléré de nouvelles technologies qui se transforment sans cesse.
La norme de groupe est la septième contrainte. Elle renvoie à tout ce qui est prescrit, permis ou interdit implicitement ou explicitement à propos des nombreuses pratiques de la vie quotidienne. C’est une transposition directe des travaux de Claude Lévi-Strauss sur la parenté qui distingue les femmes permises, prescrites ou interdites[26]. Ces normes renvoient aux codes vestimentaires, alimentaires, professionnels ou éthiques. La plupart des comportements humains se conforment à ces normes. La conformité est une des conditions de la vie en société. Cependant la conformité peut aussi menacer la créativité et donc la survie d’une société ou d’un groupe. La transgression est donc nécessaire. Cependant transgresser peut avoir un coût social élevé sous forme de rejet et d’isolement.
Les réseaux sociaux « prénumériques » et numériques, la huitième contrainte, sont les producteurs des normes sociales en faveur ou en défaveur de tel ou tel changement. Ils sont aussi les conducteurs de l’information qui sera mobilisée tout au long du processus de décision. Leur rôle stratégique est donc central. Les réseaux sociaux représentent la matrice de base du jeu des acteurs en interaction les uns avec les autres. Suivant que les réseaux sociaux sont favorables ou défavorables à la nouvelle consommation ou au changement, ses chances de réussite seront fortes ou faibles.
Les deux dernières contraintes sont symboliques. La neuvième contrainte touche à l’identité personnelle. L’enquête va permettre de découvrir si le changement menace ou non l’identité masculine ou féminine, le statut social ou l’identité professionnelle. Comme on dirait en Chine on se demande si la transformation va faire « monter ou baisser la face » (面子Miànzi en chinois) des acteurs concernés par le changement. Si l’identité est menacée, il est probable que les résistances au changement seront fortes.
La dixième contrainte porte sur les risques perçus par rapport à l’alimentation, aux produits cosmétiques, aux énergies fossiles, aux nouvelles technologies ou aux nombreux objets, services et personnes qui sont inconnus. Comme anthropologue, il n’est pas possible de trancher si un nouveau médicament, un aliment ou un cosmétique est dangereux pour la santé ou pour la peau. Par contre, il est possible de montrer qu’une partie des consommateurs perçoive ce produit comme un risque. Connaître la perception d’un risque est important puisqu’une partie de la décision sera prise non seulement à partir des interactions au sein de son groupe de pairs, domestique ou professionnel, mais aussi en fonction des perceptions de chacun. Suite aux enquêtes anthropologiques, la présentation du risque perçu par les consommateurs ou les citoyens auprès d’experts scientifiques est souvent mal acceptée. Ces derniers pensent que ce comportement est irrationnel. Un des apports de l’anthropologie est de montrer la logique sociale de ce qui paraît irrationnel d’un point de vue économique, technique ou biologique aux échelles mesosociales et microsociales.
La diversité des causalités : corrélation, situation et sens
S’il est accepté que les formes de la causalité varient en fonction des échelles d’observation, cela veut dire qu’il existe plusieurs formes de scientificité dont les sciences expérimentales in vitro n’en sont qu’une parmi d’autres. De façon inattendue, la question des échelles d’observation a fait émerger petit à petit les conditions d’une production rigoureuse des enquêtes qualitatives et inductives qui n’utilisent pas la corrélation, mais l’observation des contraintes et du sens.[27] Cette question a émergé sous contrainte de recherche sous contrat. Il a fallu démontrer aux différents clients que les enquêtes qualitatives pouvaient être aussi rigoureuses que des enquêtes quantitatives, mais que leur rigueur ne relevait pas des mêmes critères de scientificité que celle des expériences de laboratoire ou des enquêtes statistiques, comme nous allons le montrer dans la conclusion.
À l’échelle macrosociale, la causalité est construite à partir des indicateurs que sont les corrélations entre des variables indépendantes et dépendantes. Elle fait apparaitre les forces qui gouvernent les sociétés, les régularités qui les organisent, les clivages qui expliquent leur conflictualité. Le sujet et les jeux d’acteurs sont invisibles à cette échelle. La causalité est extérieure aux acteurs sociaux.
Aux échelles meso et microsociales la causalité dépend de l’effet de situation et des interactions entre acteurs. La contrainte de situation est la « variable » explicative du jeu entre acteurs. Il n’y a pas de corrélation. L’explication varie en fonction des situations. La causalité est systémique.
À l’échelle microindividuelle, la causalité est une variable plus interne à l’individu.Elle relève du sens (et de la motivation ou de l’émotion) et de la cognition vue comme cadre de la perception ou comme calcul. La causalité peut relever du conscient ou de l’inconscient. La causalité peut dépendre de la corrélation en psychologie expérimentale et dans les neurosciences.
Il n’existe pas de lien mécanique entre les approches quantitatives et les approches macrosociales. Le sociologue Max Weber qui analyse la culture protestante à une échelle macro sociale, sans jeu d’acteur, n’utilise pas d’outils statistiques[28]. En pratique les approches macrosociales sont souvent associées à des approches quantitatives. De même les approches microindividuelles peuvent être qualitatives ou quantitatives. Par contre les approches mesosociales et microsociales, du fait de leurs modèles interprétatifs systémiques et interactionniste (que cette interaction soit symbolique comme dans l’école de Chicago, ou utilitariste comme dans l’analyse des organisations) utilisent peu les modèles statistiques. Par contre, il est tout à fait possible de construire un questionnaire fermé et quantitatif à partir d’une enquête qualitative ou d’utiliser des échelles d’attitudes.
Cependant il existe une subtilité. L’analyse qualitative qui suit une enquête quantitative afin d’expliquer le sens des corrélations et de la causalité à partir d’interviews n’est pas du même ordre qu’une analyse qualitative réalisée en vue d’obtenir un système d’action. Cette différence explique la discontinuité de l’observation entre les échelles. L’enquête qualitative pourra servir à faire des hypothèses pour construire un questionnaire fermé quantitatif. À l’inverse des enquêtes exploratoires qualitatives, il n’est pas possible de construire un questionnaire fermé sans faire d’hypothèses. L’analyse quantitative qui sera construite à partir d’une enquête qualitative ne sera pas non plus du même ordre qu’une enquête quantitative. Son objectif principal sera de pondérer le poids de certains comportements repérés pendant l’enquête qualitative. C’est pourquoi, cette enquête quantitative ne relève pas forcément de l’échelle macro sociale.
Dans une enquête quantitative, la causalité relève du pourquoi dont l’indicateur est l’émergence d’une corrélation forte. Dans une enquête qualitative basée sur un système d’action, la causalité relève du comment. La description du jeu des acteurs dans une situation donnée permet de montrer comment chaque acteur joue et sous quelle contrainte. La contrainte devient la causalité qui explique le comportement des acteurs qui peuvent se conformer ou transgresser cette contrainte. Si la situation change, et donc que la contrainte change, le comportement des acteurs va changer. L’important est donc bien de décrire comment fonctionne la situation d’interaction sociale.
Il existe une autre confusion fréquente qui est de confondre le macrosocial avec le niveau central par rapport au local. En réalité, le lien entre un niveau de décision centrale et un niveau local relève d’une enquête stratégique en termes de système d’action et donc de l’échelle mesosociale. Enfin, il ne faut pas confondre le fait de travailler à une échelle macrosociale et d’avoir atteint un niveau de généralisation plus fondamentale qu’à une échelle microsociale. Il est possible de généraliser à toutes les échelles, mais la portée de cette généralisation n’est valable qu’à l’intérieur de la même échelle d’observation. C’est donc une généralisation limitée par différence avec une généralisation globale qu’il est impossible d’atteindre dans les sciences humaines et sociales, comme aussi en physique quantique, semble-t-il. Quand il s’agit d’enquête qualitative, le critère de généralisation relève d’une autre logique de la preuve et de l’extension des résultats.
Conclusion : les 10 règles de la rigueur pour des enquêtes qualitatives, inductives et appliquées en anthropologie[29]
Règle 1 : La méthode qualitative inductive n’est utile que si elle permet de libérer la pensée. Si la méthode inductive empêche de réfléchir, d’explorer ou de transgresser, il vaut mieux en choisir une autre. Elle est à l’opposé de la méthode basée sur la recherche de l’état de l’art qui cherche plus souvent à vérifier qu’à explorer. Elle est plus sensible à la qualité des données présentées qu’aux concepts théoriques et aux définitions a priori. La méthode inductive permet de donner un semblant d’ordre au désordre des sociétés, tout en respectant la part d’incertitude du présent et d’aléatoire du futur.
Règle 2 : L’observation est à la base de la méthode inductive. La description est un moyen d’explorer la réalité grâce à des hypothèses méthodologiques en termes de système d’action, d’itinéraire, d’effets de cycle de vie ou d’échelle d’observation. La description, la comparaison, l’analogie, l’intuition et le recoupement des informations constituent les 5 outils de l’observation inductive. Le moment clé de la méthode est celui du recueil de l’information, qui dépend des techniques de recueil de l’information et des méthodes de classement des faits observés. C’est une approche cumulative qui part des cadres de la connaissance acquise au cours des enquêtes antérieures de l’anthropologue. D’un point de vue épistémologique, ces cadres sont en partie liées à la « psychologie » de l’observateur. À cela s’ajoutent de nombreuses lectures qui portent sur des sujets à des échelles variées.
Règle 3 : La réalité est continue, l’observation est discontinue. On ne peut pas observer en même temps les pratiques et les représentations, le sens et l’intérêt, les classes sociales et l’individu, l’émotion et le rationnel, des corrélations et des effets situation. Il n’existe pas d’observation globale de la réalité. L’approche inductive est une ascèse, car elle demande de résister le plus longtemps possible au fantasme de toute-puissance de contrôle de la réalité dans un seul système théorique. C’est pourquoi les sciences humaines portent sur la recherche du vrai et non pas de La Vérité. Il n’y a pas de connaissance sans découpage, et donc sans biais d’observation. En sciences humaines, le biais est un moyen de travail alors qu’il est un obstacle en sciences expérimentales. La cohérence logique abstraite n’est pas un critère de vrai dans les sciences humaines. Le paranoïaque est très cohérent.[30]
Règle 4 : Toute réalité sociale est ambivalence. Toute réalité comprend une face négative et une face positive. Elles sont indissociables, comme le Yīn et le Yáng 阴阳.
Règle 5 : La généralisation ne peut porter que sur la diversité des pratiques ou des usages en fonction de leur occurrence. En qualitatif la diversité des occurrences est la seule preuve de « vrai », aux échelles méso et microsociales. Il faut donc éviter toute interprétation en termes de fréquence, ce qui n’a pas de sens statistique vu les faibles échantillons qualitatifs de 20 à 200 personnes des enquêtes anthropologiques. Une fréquence quantifiée n’est donc pas plus vraie que la diversité des occurrences. Elle nous apprend autre chose et tout particulièrment les régularités hors effet de situation.
Règle 6 : L’enquête anthropologique est compréhensive. Elle part du point de vue des acteurs pour comprendre leurs pratiques, leurs expériences et le sens qu’ils leur donnent. Il est aussi recherché les logiques sociales sous-jacentes, les enjeux au-delà de la seule perception ou du vécu des acteurs. On ne part pas de définition a priori. C’est une approche critique, qui déconstruit une partie des modèles explicatifs spontanés pour montrer d’autres angles d’approches possibles. Elle cherche à objectiver sans jugement de valeur ni dénonciation.
Règle 7 : Respecter un principe de symétrie des enquêtes. Il faut mener des enquêtes autant sur des projets qui ont réussi que sur des projets qui ont échoué. La réussite ou l’échec d’une action dépend des contraintes du jeu social dans laquelle elle est encastrée. Sa transposition comme « bonne pratique » dans un autre univers social ne va donc pas de soi puisque les situations ne sont pas forcements équivalentes. De plus le terme de réussite ou d’échec dépend du point de vue des acteurs et donc dépend de la situation et de qui perd ou gagne au changement.
Règle 8 : Acquérir un agnosticisme méthodologique. Être agnostique, c’est s’interdire d’affirmer que parce qu’on n’a pas vu une chose elle n’existe pas. C’est accepter qu’un phénomène invisible pour un observateur soit visible et vrai d’un autre point de vue (relativisme méthodologique).
Règle 9 : Accumuler des enquêtes empiriques. L’induction est une méthode clinique qui demande pour être pertinente de réaliser de très nombreuses enquêtes de terrain.
Règle 10 : Pratiquer une connaissance mobile. Les cadres de la connaissance sont encastrés dans les méthodes et les techniques de recueil de l’information. Il fonctionne en synergie suivant un mouvement perpétuel qui constitue une connaissance mobile dont la méthode des échelles d’observation en est l’outil de base.
Ce « décalogue épistémologique » présente des règles ouvertes qui se sont constituées au fil des enquêtes qui représentent autour de 150 contrats, en une cinquantaine d’années, et donc autant de négociations commerciales et épistémologiques pour argumenter sur la scientificité des enquêtes qualitatives. Il faut démontrer qu’elles sont utiles quand elles prennent en compte les usages et les pratiques des acteurs dans une organisation ou dans un espace domestique, ainsi que leur imaginaire et les relations de pouvoir qui organisent leur prise de décision. Ces enquêtes ont le plus souvent permis d’expliquer pourquoi telle innovation, tel projet, tel nouveau produit, tel changement, tel système collaboratif, telle politique publique ne marchaient pas, et ceci grâce aux 10 contraintes. Elles ont été construites au fur et à mesure des enquêtes. C’est pourquoi elles permettent d’expliquer un grand nombre de situations aussi bien dans le monde des organisations, que dans les univers domestiques ou que dans l’espace public des mouvements sociaux.
Cependant il est probable qu’aujourd’hui les défis auxquels nous somment confrontés nous amènent à changer nos méthodes et nos modes de raisonnement. On peut se demander si dans le champ du développement durable qui porte sur la consommation économe d’énergie, la diminution de la production de gaz à effet de serre, la réduction de la pollution, les transformations des comportements culinaires et alimentaires, en faveur des protéines végétales notamment, n’est pas en train de changer le processus « traditionnel » d’innovation que l’on connaît depuis le milieu du XVIIIe siècle avec l’émergence de l’usage intensif du charbon à partir de l’Angleterre[31].
Si on regarde les processus d’innovation technologique depuis 200 ans dans l’agriculture, l’industrie, le commerce et dans l’espace domestique, qui pour la plupart ne se préoccupaient pas des conséquences écologiques du changement provoqué, on constate qu’innover signifiait simplifier, gagner du temps, dépenser moins d’énergie humaine, augmenter la productivité, payer moins cher. Or les transformations demandées aux entreprises et aux consommateurs par le développement durable sont en partie contradictoires avec ses cinq pratiques et donc transforment potentiellement tout notre rapport au monde.
L’anthropologie appliquée représente une chance non pas parce qu’elle est la meilleure discipline, mais parce qu’elle a acquis une compétence celle du détour par des pays inconnus et donc une capacité à explorer des problèmes sans avoir de point de repère ni de solutions toutes faites.
[1] Cf. sur les paliers en profondeur, le livre de Georges Gurvitch, 1950, La vocation actuelle de la sociologie, PUF
[2] Vidéo sur les échelles d’observation adaptée d’une vidéo américaine de 1977 « Powers of Ten » ; une vidéo sur les échelles vue d’un point de vue chinois
Source : Powers of Ten takes us on an adventure in magnitudes. Starting at a picnic by the lakeside in Chicago, this famous film transports us to the outer edges of the universe. Every ten seconds we view the starting point from ten times farther out until our own galaxy is visible only a s a speck of light among many others. Returning to Earth with breathtaking speed, we move inward- into the hand of the sleeping picnicker- with ten times more magnification every ten seconds. Our journey ends inside a proton of a carbon atom within a DNA molecule in a white blood cell. POWERS OF TEN © 1977 EAMES OFFICE LLC (Available at www.eamesoffice.com)
[3] Cf. Georges Gurvitch, 1950.
[4] Silhouette-Dercourt Virginie, Saidou Sy Ousseynou, Desjeux Dominique, sous presse, “Cosmopolitan veiling in Paris: young French Muslim women in transition”, Youth and Globalization
[5] Beauvois Jean-Léon, Joule Robert Vincent, 1987, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, PUG
[6] http://www.argonautes.fr/2012-11-d-desjeux-comment-apprivoiser-le-hasard/
[7] Bronner Gérald, 2007, L’empire de l’erreur. Éléments de sociologie cognitive, PUF
[8] Cité par Barrault Servane, 2012, Études des distorsions cognitives, des troubles anxiodépressifs
et de la personnalité chez des joueurs pathologiques en ligne, thèse de doctorat en
psychologie à l’Université Paris Descartes.
[9] Akerlof George A., Shiller Robert J., 2009, Les esprits animaux. Comment les forces psychologiques mènent la finance et l’économie, Pearson
[10] PowerPoint sur la méthode des itinéraires et des échelles
[11] Gouldner Alvin W., 1955, Patterns of Industrial Bureaucracy, Routledge
[12] Crozier Michel, 1963, Le phénomène Bureaucratique, Seuil
[13] Bailey F. G., 2001, Strategems and Spoils. A Social Anthropology of Politics, Westview
[14] Briody Élisabeth, Trotter II Robert T, Meerwarth Tracy L., 2010, Transforming Culture. Creating and Sustaining A Better Manufacturing Organization, Palgrave Macmillan
[15] Hung-Sying Jing, Batteau AW. Allen, The Dragon in the Cockpit. How Western Aviation Concepts Conflict with Chinese Value Systems, Routledge
[16] Batteau w. Allen, 2010, Technology and Culture, Waveland Press
[17] Cf Telt Gillian, 2015, The Silo Effect. Organization Needs to Disrupt Itself to Survive, Abacus
[18] Sur le lien entre publicité et anthropologie cf. De Waal Malefyt Timothy, Moray Robert J., 2012, Advertising and Anthropology, Bloomsbury Publishing
[19] Miller Daniel, 1987, Material Culture and Mass Consumption, Blackwell
[20] Malinowski Bronislaw, 1922, Les Argonautes du Pacifique occidental, (trad. fr. 1963)
[21] Mauss Marcel, 1923-1924, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », l’Année Sociologique
[22] Desjeux Dominique, 1991, « La place de la prescription de l’enfant dans le comportement d’achat alimentaire des parents », Économie et Gestion, n° 19 avril 1991
[23] Vidéo sur la méthode inductive : observer pour innover
[24] Cf. enquête sur handicap et consommation, Dominique Desjeux, Cyril Desjeux.
[25] Desjeux Dominique, Ma Jingjing, 2018, “The Enigma of Innovation: Changing Practices of Nonalcoholic Beverage Consumption in China”, in McCaby Maryann, Briody Elisabeth K. (éds.), Cultural Change From A Business Perspective, Lexington Books. En Angleterre on utilise le terme anthropologie sociale et aux États-Unis le terme anthropologie culturelle. Sociale et culturelle ont ici un sens proche. Par contre en français le terme culturel désigne les valeurs et les représentations qui ne font pas référence aux pratiques et aux rapports sociaux.
[26] Lévi-Strauss Claude, 1949, Les structures élémentaires de la parenté, PUF
[27] Cf. Glaser Barney, Strauss Anselm, 2010, La découverte de la théorie ancrée: Stratégies pour la recherche qualitative, A Colin
[28] Weber Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme
[29] Desjeux Dominique, 2018, L’empreinte anthropologique du monde. Méthode inductive illustrée, Peter lang (2018, traduction en anglais) ; sur l’anthropologie professionnelle applicable aux organisations et aux consommateurs : Denny Rita M., Sunderland Patricia L., 2016, Handbook of Anthropology in Business, Routledge
[30] Cf. la sorcellerie au Congo et aujourd’hui, les théories conspiratoires du pouvoir in Desjeux Dominique, 2018, L’empreinte anthropologique du monde, chapitre 6.
[31] Pomeranz Kenneth, 2010, Une grande divergence, Albin Michel