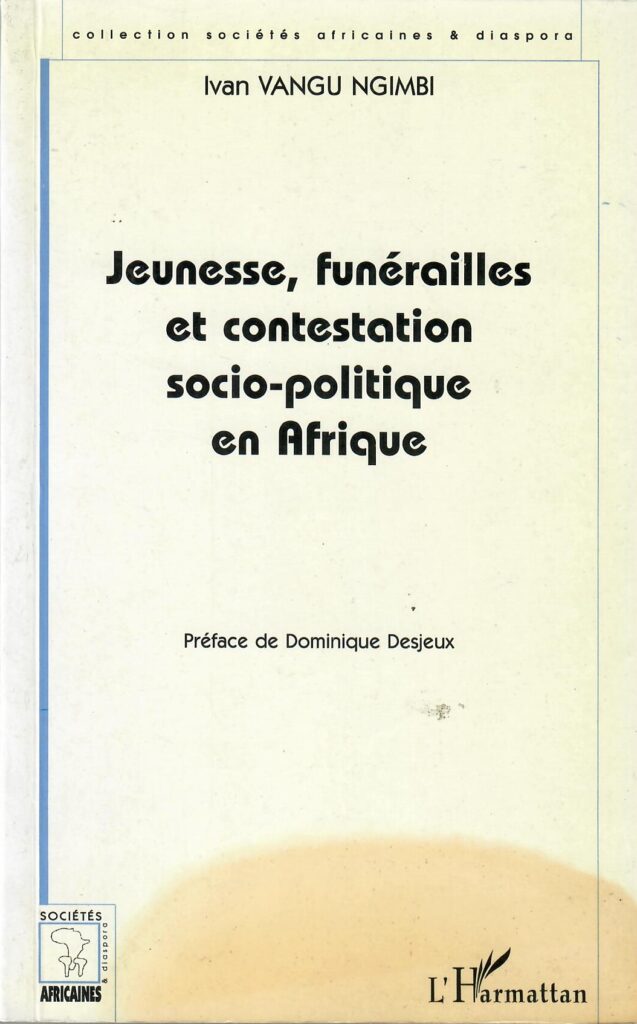
Ivan Vangu Ngimbi, 1997, Jeunesse, funérailles et contestation socio-politiques en Afrique (Le cas de l’ex-Zaïre), l’Harmattan
PrÉface
Le livre de Vangu Ngimbi est un document rare non seulement par son sujet, les cérémonies funéraires dans une des plus importantes conurbations africaines, Kinshasa, au Zaïre ; mais encore par son angle interprétatif, celui du rituel, analysé ici, comme une réinterprétation, par les jeunes, du deuil familial comme moment de protestation sociale et de contestation politique ; mais surtout par la prise de risque personnelle que constitue une telle enquête de terrain par un chercheur africain dans son propre pays.
Pour comprendre ce risque, j’aimerais rappeler une « évidence invisible » sur l’enquête empirique, et l’élucidation sociale des réalités quotidiennes qu’elle suppose. Le jeu de miroir dans lequel s’inscrivent les sciences humaines ne va jamais de soi, même dans nos sociétés occidentales et tout particulièrement en France où toute notre culture de l’information peut être ramenée à la célèbre distinction de Jean de La Bruyère opposant Racine qui « peint les hommes tels qu’ils sont », comme le sociologue ou l’anthropologue, à Corneille qui « peint les hommes tels qu’ils devraient être ». Or aucune société n’accepte spontanément l’image « réaliste » que les sciences humaines ou la psychanalyse lui renvoient. Le succès du postmodernisme s’explique en ce qu’il comble, à l’opposé des sciences humaines et sociales, notre besoin d’enchantement esthétique, affectif ou moral.
Les sciences humaines nous apprennent qu’il nous faut gérer alternativement des connaissances réalistes qui désenchantent le monde, comme moment nécessaire pour que s’exprime la raison et se révèle le monde tel qu’il est, et un imaginaire qui l’enchante, qui lui donne sens et conditionne le passage à l’action. Mais cette vision du monde propre aux sciences humaines, qui est née en occident — et dont on oublie qu’elle peut être considérée comme une « conquête sociale », c’est-à-dire comme un des éléments du dispositif démocratique de création d’informations différentes de la vision du monde dominante d’une époque, d’une classe, ou d’une minorité —, ne va pas de soi en Afrique, surtout quand elle porte sur l’intimité d’une société comme ici la mort et les « sorciers ».
Imaginons, à Paris, un sociologue qui enquête sur les enterrements. Il s’invite aux cérémonies pour observer les pleurs des familles. Il prend des photos à la mairie, à l’église et au cimetière. Il enregistre les disputes entre les adultes autour des questions d’héritage ou les plaisanteries qui fusent après le repas de deuil du grand-père ou de la grand-mère. Sociologiser cette intimité paraîtra bien souvent en France réducteur, indécent ou indiscret. Si c’est bien le cas, on comprendra encore mieux la difficulté d’une telle enquête en Afrique réalisée, non par un ethnologue blanc, mais par un chercheur noir. A la difficulté d’aller à l’encontre de la pudeur admise socialement, il faut ajouter, pour le sociologue africain, le risque physique de l’agression en « sorcellerie », voire le risque de répression politique par rapport au pouvoir en place au Zaïre. À la lumière de ces risques personnels et du contexte géopolitique de crise qui secoue l’Afrique des hautes terres, entre le Rwanda, le Burundi et le Zaïre, on comprendra mieux la valeur de ce document.
Le travail de Vangu Ngimbi relève de l’anthropologie urbaine moderne et de la sociologie comparative du quotidien. Il s’inscrit dans la tradition ouverte par Georges Balandier et Louis Vincent Thomas envers qui Vangu Ngimbi rappelle sa double dette. Mais Vangu Ngimbi intègre aussi les chercheurs les plus actuels sur la protestation politique dans le monde occidental, comme Olivier Filleul, ou sur la jeunesse en France ou en Europe, comme Olivier Galland, François Dubet et Michel Fize, ou sur la politique africaine, comme Jean-François Bayard.
Sa recherche s’appuie sur une double approche symbolique et stratégique. Pour la première, il part, sans le reprendre tel quel, du modèle interprétatif élaboré par Gérard Althabe à partir de l’étude du tromba chez les Betsimisaraka de la côte Est de Madagascar, dans les années soixante : la mobilisation de l’imaginaire est vue comme un moyen de libération des contraintes du quotidien. Il le prolonge, en réinterprétant l’approche de Pierre Sansot, qui suite aux travaux pionniers de Gilbert Durand sur l’imaginaire, voit celui-ci comme un mode de structuration de la protestation sociale ou politique, comme un moyen d’agir sur le réel. Pour la seconde, il montre à la suite des travaux de Babacar Sall ou d’Emmanuel Ndione sur Dakar, et de Tcha-Koura sur le Burkina Faso, qu’il est possible d’appliquer une analyse en termes d’intérêt et de rapport de pouvoir, sur le modèle de Michel Crozier et d’Erhard Friedberg, aux comportements symboliques et culturels en Afrique.
Cette double approche lui permet de montrer que les comportements des jeunes, souvent sans emploi, ne relèvent pas tant de la délinquance, — ce qui serait plutôt l’interprétation spontanée du sens commun africain —, que de la contestation politique et de la critique du pouvoir des « aînés sociaux ». Il montre que la mort des jeunes à Kinshasa est l’occasion de développer deux formes de contestation organisationnelle et symbolique. La première consiste à mettre en place dans les quartiers pauvres de Kinshasa des groupes d’animateurs de deuil organisés par des jeunes, à l’exclusion des adultes, et qui prennent en charge toute la cérémonie à la place des « vieux ». La deuxième consiste à détourner le sens des chants traditionnels de deuil au profit d’allusions sexuelles, souvent très directes — ce qui n’est pas sans rappeler le célèbre « nique ta mère » des banlieues parisiennes —, ou de jeux de mots codés contre les oncles maternels qui « mangent » les jeunes — les font mourir —, pour s’enrichir, et contre le pouvoir politique de Mobutu ou des églises.
La violence des paroles, notamment sexuelles, — faites de mots crus qui ne vont pas de soi en Afrique contrairement aux images que l’Européen peut se faire d’une liberté sexuelle africaine plus fantasmatique que réelle —, exprime dans l’imaginaire le symétrique de la violence des adultes faite aux jeunes, qu’elle soit réelle ou persécutive. Que ce soit dans les accusations de « sorcellerie » qui traditionnellement accompagnent tout rituel mortuaire, ou que ce soit par rapport à la non-redistribution des richesses ou à l’accaparement des femmes — les « deuxièmes bureaux » —, par la classe politique, les funérailles sont réinterprétées par les jeunes comme une « mise en scène de cette crise de la redistribution ».
L’intérêt du travail de Vangu Ngimbi ne relève pas seulement dans ce qu’il nous apprend sur l’Afrique et sur l’une des plus grandes mégalopoles du continent, il nous révèle en quoi les phénomènes de génération, et leurs tensions structurent tout particulièrement les sociétés des années quatre-vingt-dix. La contestation des jeunes chômeurs africains fait échos à celle des jeunes européens, sud-américains ou d’ailleurs, et à celle de tous ceux qui sont touchés par la précarité et par la non-redistribution, face à une génération, notamment celle des « baby boomers » pour la France ou les USA, par exemple. Même si cette génération au sens fort, ceux qui sont nés entre 1945 et 1950, est aussi une génération « sandwich », entre les grands-parents dont il faut assumer matériellement le vieillissement et les jeunes au chômage dont il faut aussi assurer la sécurité économique, elle maîtrise en partie aujourd’hui une part des postes de commande.
Si les années soixante, et avant, ont été celles des conflits de classes, les années soixante-dix, celles des conflits de sexes, les années quatre-vingt-dix pourraient bien être, non seulement celles des conflits interculturels, mais aussi celles des conflits de générations. L’anthropologie est là pour nous rappeler que toute société est structurée par quatre grandes divisions de classes, de sexes, de générations et de cultures et que suivant les époques de l’histoire un conflit plus central organise l’ensemble de la société, même si les autres sont toujours présents, mais sur un mode mineur.
Dominique Desjeux, professeur d’anthropologie sociale et culturelle à la Sorbonne (Paris V)
Paris, le 24 12 1996

