
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie, 2013 en anglais, 2014 en français (édition 2017).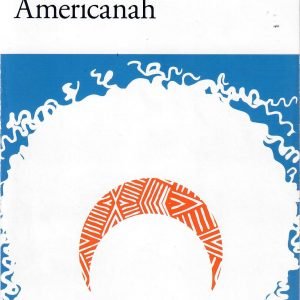
Americanah n’est pas simplement une œuvre littéraire déjà très connue par une grande auteure nigériane. C’est aussi un regard ethnologique affûté sur la vie quotidienne au Nigeria, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, tout autant que sur le monde universitaire, la gauche américaine ou les rapports entre Afro-Américains et Africains.
C’est en filigrane une réflexion subtile sur le racisme et les difficultés des migrants, y compris au Nigeria avec les Ghanéens, où il existe des sacs Ghana must go qui sont des « genres de cabas devenu symbole d’un mouvement incitant les réfugiés ghanéens à retourner chez eux » (p. 561). Sur l’immigration en Grande-Bretagne elle écrit : « Le vent qui soufflait à travers les îles britanniques était chargé des peurs suscitées par les demandeurs d’asile, engendrant chez tous la crainte d’une catastrophe imminente, et ces articles étaient écrits et lus, naturellement et avec obstination, comme si leurs auteurs vivaient dans un monde déconnecté du passé, sans avoir jamais envisagé que cette situation était un développement naturel de l’histoire. L’afflux en Angleterre de citoyens à la peau noire ou brune venant de pays créé par l’Angleterre » (p. 385).
Ifemelu, l’héroïne, tient un blog qui lui permet de communiquer et d’échanger sur ses observations avec les Noirs non américains et les Africains américains. Leurs rapports ne sont pas simples, puisqu’une partie des Africains américains reproche aux Africains de les avoir vendus au moment de l’esclavage, comme le rappelle le film de Bruno Moynie (https://vimeo.com/230621863)
Dans son blog, elle décrypte les codes imposés aux Noirs non américains et qui sont pour elle les signes du racisme socialement imposé : « voilà à quoi expose le fait d’être noir : tu dois te montrer offensé quand on utilise des mots tels que “pastèque” ou “goudronné” à titre de plaisanterie, même si tu ne sais pas de quoi on parle — et puisque tu es un Noir non américain, il y a toutes les chances que tu ne le saches pas.
Tu dois répondre par un signe de tête quand une personne noire te fait un signe de tête dans un environnement majoritairement blanc. Ça s’appelle le salut noir. C’est une façon pour les Noirs de dire : “tu n’es pas seul, je suis là aussi.”
Quand tu décris des femmes noires que tu admires, emploie toujours le mot “FORTE” parce que c’est ce que les Noires sont censées être en Amérique. Si tu es une femme, ne dis pas ce que tu penses comme tu le ferais dans ton pays. Parce qu’en Amérique les femmes noires qui réfléchissent font PEUR. Et si tu es un homme, sois super détendu, ne t’excite jamais, sinon quelqu’un pourrait craindre que tu portes un pistolet.
Quand tu regardes la télévision et entends dire qu’une “injure raciste” a été proférée, tu dois te sentir immédiatement insulté. […] Si tu racontes à un non-Noir l’incident raciste dont tu as été victime, ne montre aucune amertume. Ne te plains pas. Sois indulgent. Si possible, drôle. Avant tout, ne te mets pas en colère. Les noirs ne sont pas supposés s’emporter sur des questions racistes. Sinon tu n’attires pas la sympathie. Cela ceci ne s’applique qu’aux libéraux blancs soit dit en passant. Inutile de parler d’incidents racistes dont tu as souffert à des conservateurs blancs. Parce que le conservateur te dira que c’est TOI qui le vrai raciste et tu en resteras bouche bée. » (pp. 331-332).
Au final, elle veut surtout montrer que le racisme anti noir est unique, qu’il n’y a pas de symétrie entre les différentes formes de racisme : « Cher Américain non noir, si un Américain noir raconte une expérience vécue par un noir, je t’en prie, ne t’empresse pas de citer des exemples tirés de ta propre expérience. Ne dis pas : “c’est exactement lorsque j’ai…” Tu as souffert. Tout le monde sur terre a souffert. Mais tu n’as pas souffert du fait que tu es un noir américain. Ne trouve pas des explications alternatives à ce qui est arrivé. Ne dites pas : “oh, ce n’est pas la race, c’est l’origine sociale. Oh, ce n’est pas la race, c’est le genre.” Tu vois, en fait, les noirs américains ne VEULENT pas que ce soit la race. Ils aimeraient mieux qu’il n’existe aucun putain de problème racial. Donc lorsqu’ils disent que quelque chose est dû à la race, peut-être est-ce vraiment le cas ? […] Ne dis pas : “c’est comme l’antisémitisme.” Ce n’est pas vrai. Dans la haine des juifs, il peut y avoir de l’envie — ils sont si malins, ces juifs, ils contrôlent tout, ces juifs — et on peut dire qu’un certain respect, même s’il est teinté de rancœur, accompagne l’envie. Dans la haine des noirs américains, il ne peut pas y avoir d’envie, ils sont si paresseux, ces Noirs, ils sont si stupides, ces Noirs. » (p. 479). Tout est dit, il faut appeler un chat un chat et ne pas se cacher derrière la classe sociale ou le genre. Le racisme anti noir qu’il soit faible, moyen ou fort, est insidieusement omniprésent.
Son livre est aussi émaillé d’observations sur les étrangetés de la culture américaine pour un regard extérieur. Dans un courrier, Ifemelu, rapporte une discussion avec sa tante « tante Uju dit que j’ai fait une dépression. Tu sais que l’Amérique a une façon de tout transformer en maladie qui requiert des médicaments » (p. 542).
Certaines de ces remarques sur le monde universitaire américain sont toutes britanniques. Elles rappellent celles que l’on retrouve dans les romans d’Alison Lurie (Des amis imaginaires) ou de David Lodge (Un tout petit monde) : « j’ai parfois l’impression que ces gens vivent dans un univers académique parallèle et parle l’académicien au lieu de l’anglais, sans aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel » (p. 269). Ou encore sur les intellectuels qui lui paraissent « dépourvus de curiosité, indifférents, ils dressent leurs tentes de savoir spécialisé et restent en sécurité à l’intérieur » (p.476)
Elle se moque gentiment de leur anticonsumériste : « elle n’avait jamais compris la mauvaise querelle faite aux centres commerciaux, le reproche d’y trouver partout exactement les mêmes choses ; les centres commerciaux lui paraissaient très rassurants dans leur uniformité. Quant aux vêtements [du professeur d’université] soigneusement choisis, il avait bien dû les acheter quelque part. “Donc vous cultivez votre coton et fabriquez vos propres vêtements ?” dit-elle. Il s’esclaffa, et elle rit à son tour. » (pp. 270-271) ; sans oublier certains travers du bio « un jour, ils rendirent visite à sa tante Claire dans le Vermont, propriétaire d’une ferme bio, qui marchait pieds nus en décrétant qu’ainsi elle avait la sensation d’être connectée à la terre. Ifemelu avait-elle eu une expérience semblable au Nigéria ? demanda-t-elle, et elle eut l’air déçu quand Ifemelu lui dit que sa mère l’aurait giflée si elle avait osé sortir sans chaussures » (p. 432).
Elle remarque qu’à l’université, les étudiants sont notés sur leur participation au cours, ce qui pour elle représente du temps perdu. Cela vient « sans doute du fait que les Américains été formés, depuis l’école primaire, à toujours dire quelque chose en classe, peu importait quoi » (p.202). Elle note les codes de langage américain du genre « s’il nous arrivait malheur il ne disait pas : “désolé.” Il disait : “ça va ?” Alors qu’il était évident que ça n’allait pas. Et si vous leur disiez : “désolé”, quand ils s’étranglaient, trébuchaient, jouaient de malchance, ils répondaient les yeux écarquillés de surprise : “oh, ce n’est pas votre faute.” Ils faisaient un usage inconsidéré du mot “excité”. Un professeur était excité par un nouvel ouvrage, un étudiant était excité par un cours, un homme politique à la télévision était excité par la loi ; cela faisait au total bien trop d’excitation. » (p. 203).
De même sur la gauche américaine : « elle n’avait pas envie d’engager une conversation. Surtout avec Kelsey. Elle reconnaissait chez elle le nationalisme des Américains libéraux qui critiquaient copieusement l’Amérique, mais n’aimaient pas que vous en fassiez autant ; ils s’attendaient à ce que vous gardiez le silence, soyez reconnaissants, et vous rappelez en permanence à quel point l’Amérique était supérieure à l’endroit, quel qu’il soit, d’où vous veniez » (p. 284).
Le livre de Chimamanda Ngozi Adichie ne se réduit pas à un livre à thèse. Il est plein d’émotion, d’humour et de souffrance. Americanah est un livre humain et actuel. Americanah est respectueux des individus, de leur trajectoire, de leur grandeur et de leur mesquinerie, mais transgressif par rapport aux codes et aux normes qui organisent les sociétés américaines, britanniques et nigérianes, et c’est en ce sens qu’il est universel.

