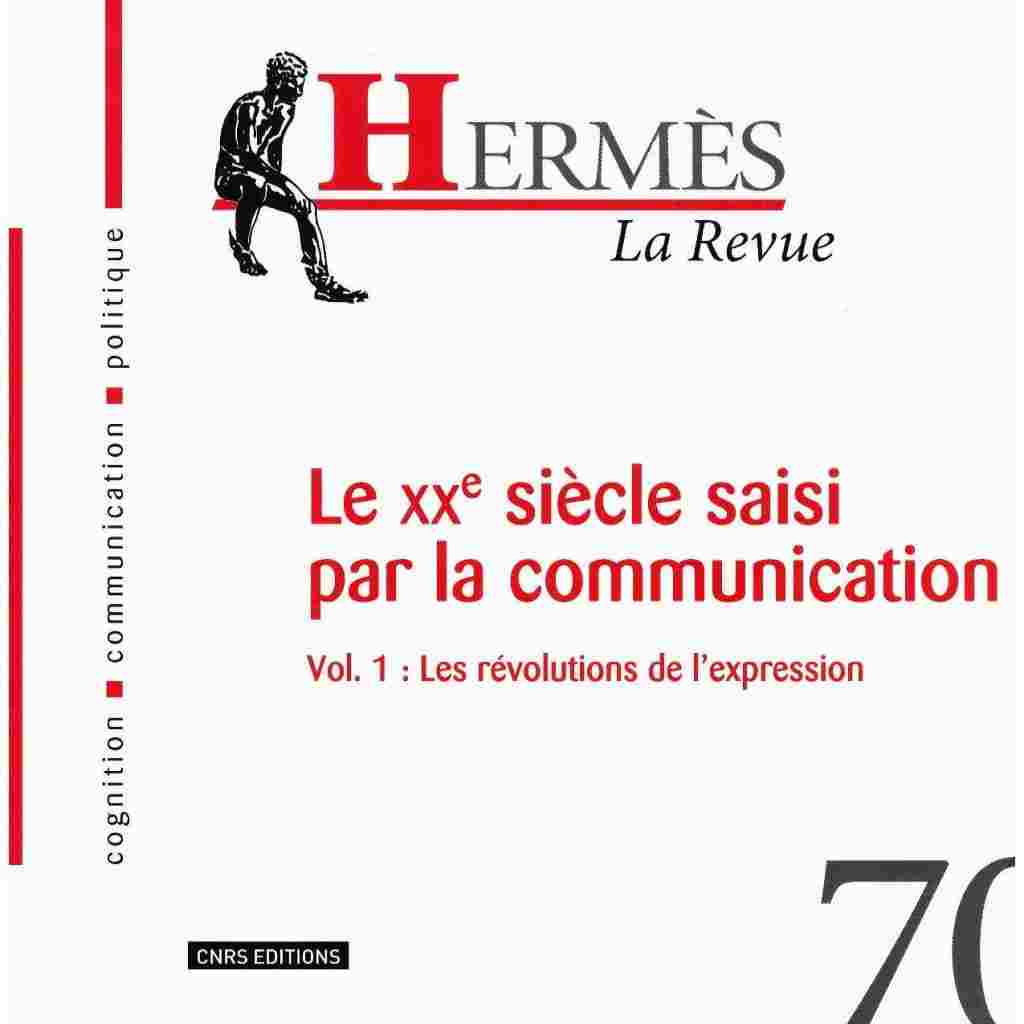2014, Desjeux D., « La communication dans le champ de la consommation », in Le XXè siècle saisi par la communication, Revue HERMES n°70, p115-119
Dominique Desjeux, anthropologue, professeur à l’université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité
D’une certaine façon, aborder la question de la communication sous l’angle de la consommation n’est pas très différent de celle de la communication en général puisque d’un côté il n’y a pas de société sans communication et donc que tout est communication et que de l’autre la communication renvoie dans le langage courant à une expression négative : « tout cela c’est de la ‘com’ » et donc que toute communication porte à suspicion. D’un point de vue anthropologique la communication est donc foncièrement ambivalente, à la fois condition de la vie sociale et source des tensions de la vie en société.
La mise en place du marketing ou l’institutionnalisation de la persuasion publicitaire
Ce qui est propre à la consommation dans nos sociétés contemporaines, depuis les années 1850, celles de l’arrivée des grands magasins et de l’émergence d’une consommation organisée à une plus grande échelle que celle des magasins de nouveautés de l’époque du « Bonheur des dames » de Zola, c’est la mise en place progressive de la réclame puis de la publicité grâce à un dispositif particulier, le marketing, et tout particulièrement dans ce dispositif, celui de la communication publicitaire. C’est l’histoire de ce dispositif, qui se met en place entre 1850 et 1914, qui est racontée par Franck Cochoy dans Une histoire du marketing, discipliner l’économie de marché (1999), d’un point de vue sociologique, et par Thierry Maillet avec Le marketing et son histoire ou le mythe de Sisyphe réinventé (2010), d’un point de vue marketing. Le marketing comme dispositif institué va se développer à partir de 1920 aux USA, puis à partir des années 1950 dans l’Europe de l’Ouest et des années 2000 pour la Chine.
D’un point de vue plus général, la publicité est une technique de persuasion. Ce point de départ se veut neutre puisque toute communication relève de la persuasion et cherche à influencer l’autre que ce soit pour son bien ou pour son mal. Comme technique de persuasion, elle cherche à influencer le consommateur final pour lui faire acheter un bien ou un service dans un linéaire de grande surface dans les années 1960, puis sur Internet, ou dans une boutique d’objets numériques dans les années 1990. La communication publicitaire est donc un dispositif qui est censé faire acheter un bien de consommation à des acteurs consommateurs. C’est donc un dispositif d’organisation de la décision, voire de sa manipulation. Cette dernière thèse a été défendue par Vance Packard dans les années 1950 dans La persuasion clandestine (1957) qui dénonce les « hameçons » mis en place par la publicité pour persuader de façon inconsciente les consommateurs. Les années 1950 correspondent aux premières enquêtes de motivation appliquée aux études du comportement du consommateur en France.
La communication publicitaire ou la confusion du sens et du vrai
Fondamentalement, le marketing comme dispositif de tentative de cadrage (framing) du consommateur, pour reprendre la thèse de Michel Callon dans The Laws of the Markets (1998) pose la question du rapport entre trois éléments : le sens qui est mobilisé dans l’imaginaire publicitaire, le vrai, – et donc la crédibilité et la confiance que l’on peut accorder à l’information diffusée par la publicité -, et le passage à l’action, ici la décision d’acheter ou non un bien de consommation. Le vrai est ici utilisé dans un sens de connaissances limitées par différence avec la vérité qui se rapproche de connaissance absolue. Il est postulé ici que si le sens permet le passage à l’action ou sa justification a posteriori il ne se confond pas avec le vrai. Autrement dit la communication publicitaire peut donner du sens et favoriser l’acte d’achat sans pour autant produire du vrai. C’est cette ambiguïté du sens qui se prend pour du vrai qui produit de la méfiance vis-à-vis de la communication publicitaire associée à une marque. Cette méfiance émerge à la fin des années 1970 et au début des années 1980 au moment où la marque devient un élément clé de la communication publicitaire, ce qu’elle n’était pas pendant la période des « 30 glorieuses ». À la fin des années 1990, suite à la crise économique qui touche fortement au pouvoir d’achat des consommateurs les plus démunis, cette méfiance vis-à-vis de la marque et des entreprises devient un phénomène qui commence à inquiéter les marqueteurs. Ils développent un argumentaire psychologique sur le fait que les consommateurs deviendraient « infidèles » à la marque.
L’émergence de la méfiance pose à son tour la question de la toute-puissance réelle ou relative de la communication dans un jeu social familial ou organisationnel, ceci variant en fonction des échelles d’observation (cf. D. Desjeux, 2006, Les sciences sociales). Ce jeu est fait d’interactions entre acteurs, de relations de pouvoir, de coopérations, d’effet d’institution et donc de contraintes qui freinent la fluidité de la communication ce qui relativise son efficacité.
Il est donc probable que les critiques qui sont faites à la communication publicitaire, un des cœurs du champ de la consommation contemporaine, relève d’une surévaluation du pouvoir publicitaire, d’une surévaluation de sa capacité à dominer et à manipuler. Mon hypothèse est que cette surévaluation du pouvoir du marketing est une des sources de la décrédibilisation de la communication dans les sociétés contemporaines.
Comment une partie des marqueteurs surévaluent la toute puissance de l’imaginaire au détriment des contraintes de réalité
Une partie des publicitaires, comme Jacques Séguéla dans les années 1980 qui préconisent la communication publicitaire comme moyen de pallier à la faible croissance économique, surestime eux-mêmes les effets de leurs actions de communication. Ils sous-estiment les effets de société dans lesquels sont encastrés les processus de décision collectifs dans les familles ou dans les grandes organisations, effets qui limitent les effets de leur communication. La surévaluation tient à la seule mise en valeur des campagnes publicitaires qui ont été des succès, comme la célèbre campagne de 1981 de « l’afficheur qui tient ses promesses » avec la non moins célèbre photo de Myriam qui déclare « le 4 septembre j’enlève le bas ». Leurs succès font oublier leurs symétriques inversés, les campagnes qui ont échoué et qui sont bien plus nombreuses que l’on ne le croie dans la grande consommation notamment. Il semble, car les chiffres sont rares et peu fiables que près de 80% des produits nouveaux qui sont lancés sur un marché disparaissent avant un an (cf. D. Desjeux, « Le marketing entre cadrage, consommateur acteur et nouvelle émergence sociétale », in marketing : remède ou poison ?, 2013, P. Bourgne (éd.).
Ceci n’est pas une critique des échecs, mais une critique de leur sous-évaluation qui me parait participer de la critique faite à la légitimité de la communication par surévaluation de sa capacité à manipuler. Travailler sur les échecs permet de mieux faire la part de ce qui relève du contenu de la communication et de ce qui relève de forces sociales souvent invisibles qui organisent les choix des consommateurs. Le cas le plus frappant, entre 1992 et 1997, puis depuis 2008 est celui de la sous-estimation par le marketing des contraintes de pouvoir d’achat qui pèsent sur les classes moyennes les plus démunies, soit autour de 30% à 40% des français suivant que l’on intègre ou non telle ou telle dépense contrainte comme le logement, l’énergie, la mobilité et les activités numériques. Les contraintes de pouvoir d’achat réduisent fortement leur capacité à se laisser séduire.
Une partie des marqueteurs continuent à ne raisonner qu’en termes de marque et de plaisir, et donc de persuasion, et donc comme si le consommateur était libre et sans contrainte, comme s’il n’était qu’un être de « désir », ce qu’il est bien évidemment par ailleurs comme sujet individuel, comme on peut l’observer à l’échelle micro-individuelle. Les effets de la communication publicitaire sont en pratique réinterprétés par les effets de sociétés et de géopolitique qui organisent la réception des consommateurs et donc leur passage à l’action d’achat. On le constate notamment avec le développement économique des BRICs (Brésil, Russie, Inde, Chine) à partir de la fin des années 1990, qui pèsent aujourd’hui sur les cours des matières premières, de l’énergie et des protéines qui à leur tour pèsent sur les budgets des familles sous contrainte de pouvoir d’achat. La persuasion publicitaire est fortement limitée par ces contraintes budgétaires qu’elle ne sait pas bien prendre en compte.
La mis en valeur de l’intention de manipuler par les « antipubs » suffit-elle à prouver son efficacité ?
La surévaluation des effets de la publicité, est aussi le fait des militants « antipubs », comme ceux décrits par Elsie Viguier dans sa thèse de 2012 soutenue à Grenoble sur Pub/anti pub, deux visions du monde ? Ou des analystes de la communication vue sous l’angle de l’émission et non pas de la réception. Je pense aux travaux, par ailleurs stimulants, de Christian Salmon, sur le Storytelling, la Machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (2007) ou ceux d’Atmand Mattelard et d’André Vitalis sur Le profilage des populations, du livret ouvrier au cyber contrôle (2014) qui sont tous publiés à La Découverte. Ces livres montrent bien les intentions des émetteurs, comment ils veulent nous cadrer, nous dominer, nous manipuler, contrôler notre vie privée, ce qui est tout à fait vrai en termes d’intention, et donc éveil notre attention au problème, mais dont il n’est donné que peu de preuves empiriques de ses effets concrets sur les acteurs, c’est-à-dire sur leur passage à l’action réelle. La grande faiblesse des approches en termes de domination et de formatage est qu’elles sous-estiment les jeux d’acteurs à l’inverse de ce qui a été montré par Ervin Goffman dans Asiles dès les années 1970 et qui paradoxalement a été publié en France par Pierre Bourdieu. Goffman nous rappelle qu’un malade mental, sensé être non rationnel, enfermé dans un monde totalitaire, et donc censé être dominé, peut malgré tout développer un jeu social et contourner les règles.
La crainte de la domination est un des enjeux des débats sur les « big data », ces données numériques que l’on recueille au moment des commandes par « Internet », au sens très large, et qui permettent grâce à des algorithmes, plus ou moins sophistiqués, de cibler les usages et donc les achats potentiels des consommateurs comme le fait Amazon pour les livres, ou encore Facebook ou Google de façon plus large. Les « mega données » explosent entre 2000 et 2014. Il est normal d’avoir peur, et la peur est un capteur indispensable de prise en compte des dangers qui nous menacent. La question posée ici ne porte pas sur l’intention, mais sur la preuve de l’efficacité de cette intention au moment de la réception, sauf à concevoir les consommateurs comme des non-acteurs passifs et les dispositifs de communication comme tout puissant, ce qui devient infalsifiable. L’infalsifiabilité entraine la transformation de la peur d’un objet en une angoisse diffuse qui n’est plus contrôlable. Cette angoisse explique pour une part les « personnalités autoritaires » et la montée des demandes de régime autoritaire hier, comme le montrait déjà Adorno en 1950, et aujourd’hui. L’infalsifiabilité fonde aussi toutes les théories conspiratoires du pouvoir, non pas celles qui inventent une conspiration, la plus classique, mais celles plus subtiles, qui postulent un lien non prouvé entre une intention et un effet, et ici entre une intention de dominer et de manipuler par la communication et des effets réels. Il faudrait juste se demander pourquoi il n’y a pas d’effet de communication simple quand on cherche à faire « le bien », et pourquoi quand on cherche à faire le « mal », à dominer, cela marcherait tout seul. La faiblesse des approches anti communication publicitaire est de surévaluer, sans preuve, ce lien de cause à effet.
Dans le développement de la consommation, l’usage bien souvent précède le sens
C’est le fait que la publicité produise de l’imaginaire, et donc de l’émotion et du sens, qui explique aussi le phénomène de surévaluation de son efficacité. En effet, le sens et l’émotion ont pour particularité de produire un sentiment de vrai. La production de sens est notamment visible dans le processus de production identitaire de l’enfance à la jeunesse adulte, comme on peut le voir avec l’évolution des pratiques de maquillage. Elles démarrent comme consommation de masse dans les années 1950, d’abord pour les jeunes filles, puis pour les lycéennes, puis les collégiennes dans les années 1990. Elles structurent aujourd’hui tout le long des étapes du cycle de vie, (D. Desjeux, La consommation, 2006).
Ce qui change tout dans les années 1980, c’est l’importance qui est accordée à la marque et non plus au produit et à ses usages sociaux. La marque devient autonome et en ce sens « irréelle » et donc sujette à méfiance. La publicité renvoie depuis trente ans à un double mécanisme anthropologique, producteur de sens, l’animisme et la transsubstantiation immanente. C’est un mécanisme que l’on retrouve sur un mode transcendant dans le rituel de la consécration dans la messe catholique. Le mécanisme animiste est contenu dans la « promesse » publicitaire qui propose en fonction des produits une jeunesse éternelle, une nouvelle énergie, et plus généralement un monde sans problème, une « libération dans l’imaginaire » des contraintes du quotidien. Ce message publicitaire est incorporé comme un animus dans le bien matériel qui sera acheté par le consommateur. Le bien est donc chargé d’une énergie, d’une « âme » qui est censée se transmettre à l’acheteur.
La transsubstantiation est représentée par la marque qui est présentée comme une personne à qui il faut être fidèle et qui doit donner confiance. Le principe publicitaire est donc de transformer un objet ordinaire en un objet qui devient une personne, la marque, et qui possède une énergie, la promesse publicitaire.
La fonction de la marque est de transformer un produit « froid » émotionnellement en un produit « chaud ». C’est cette transsubstantiation qui donne du sens et qui explique le rôle réel de la marque. Cependant la marque ne fait pas acheter. La marque sert à choisir entre deux produits équivalents qui ont été préalablement codés de façon différente par la marque et par l’énergie qui lui est associée.
Cela veut dire que l’achat d’un bien ou service ne dépend pas d’abord de la marque, mais de l’usage du bien et des problèmes matériels, sociaux ou symboliques que les acteurs doivent résoudre dans leur vie quotidienne. Dans cette perspective, qui n’est pas la seule, l’usage précède le sens. Les ordinateurs, les téléphones mobiles, les réseaux divers ne se seraient pas développés si les interactions sociales, si les réseaux « prénumériques » n’avaient pas préexisté aux réseaux numériques. Les nouvelles technologies de la communication sont encastrées dans les jeux sociaux qui leur préexistent, comme le montre une enquête sur Facebook que j’ai eu à analyser en 2013, et qui rappelle que son usage le plus important est d’abord au sein de la famille et des amis. De nouveaux usages, comme la photo, sont ensuite apparus à travers des applications comme Instagram (2010), ou des pratiques comme les « selfies » (2012), ces autophotos envoyées aux amis par Internet par les adolescents, mais dont la fonction phatique de maintien du lien social, un des grands usages de Facebook, lui préexistait, de même que la fonction narcissique des « selfies ».
Trop de réenchantement tue le réenchantement
Au final, ma démonstration tourne autour d’un argument central : le marketing ne pose pas de problème en soi comme technique de persuasion et de vente. Cependant la généralisation des dispositifs de communication publicitaire à toutes les sphères de la vie publique a introduit une confusion entre la pensée magique qui donne du sens à la vie, mais de façon fluide et sans résistance, et le passage à l’action qui est sous contrainte du jeu social et donc ne relève pas du fluide. C’est la surévaluation du fluide et du magique par le marketing publicitaire qui a conduit à une part du discrédit de la communication. Ce discrédit vient du désenchantement qui nait de l’écart vécu entre l’enchantement publicitaire et les résistances de la vie quotidienne. Tout se passe comme si derrière l’enchantement publicitaire gisait le désenchantement réaliste qui participe pour une part au discrédit qui affecte la communication.
Paris -Guangzhou le 22 aout 2014